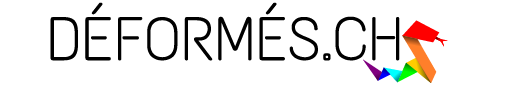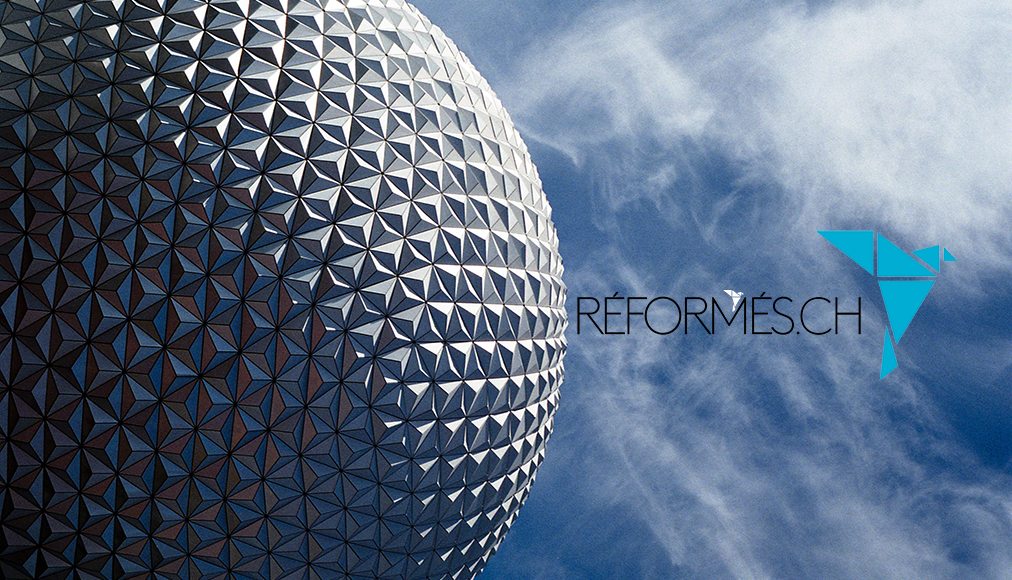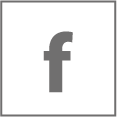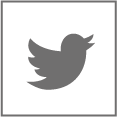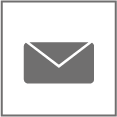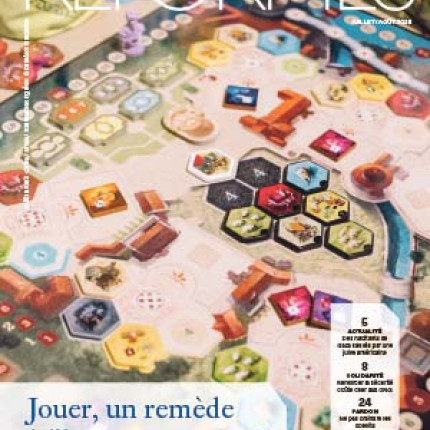Pour ne pas licencier, l’EERV titille la loyauté de ses membres
Quatre ans après une réorganisation déjà motivée par un souci de rationalisation, l’Eglise réformée vaudoise (EERV) se voit touchée de plein fouet par les mesures d’assainissement décidées par le gouvernement : son budget de fonctionnement a été sérieusement amputé. Un découvert de "quelque 2 millions 130'000 francs", précise le chancelier Claude Cuendet. Samedi 5 mars, le Synode vaudois a d'ailleurs accepté le principe d'une suppression de 18 postes: dix dans les régions et huit dans les différents postes cantonaux. « Un tel déficit impliquera forcément, à terme, que l’Eglise renonce à certaines de nos tâches actuelles, rappelle le membre permanent du Conseil synodal Antoine Reymond. En juin prochain, le Synode se prononcera ainsi sur un certain nombre de priorités. « Nous devrons aussi expliquer à la population que cela signifie moins de ministres dans les hôpitaux, les paroisses et les EMS, moins de disponibilité pour les mariages ou les enterrements », note encore Antoine Reymond.
En attendant de mener à bien cette réflexion de fond, et comme il a été expliqué lors du Synode extraordinaire de samedi à Malley, l’EERV a dû agir vite, puisque ces coupes budgétaires s’appliquent cette année déjà. « Partant du principe que notre richesse est avant tout humaine, notre priorité était de ne pas procéder à des licenciements », souligne Antoine Reymond. L’EERV a choisi deux autres moyens de résorber ce manque à gagner, puisque la mise à la retraite anticipée d’une douzaine de ministres n’y suffira pas : d’une part, un prélèvement sur sa fortune, et de l’autre la création d’un fond de solidarité. Dans l’immédiat, l’institution doit puiser dans ses réserves financières. Exercice nécessaire mais dangereux, car il peut rapidement péjorer l’avenir. Le Conseil synodal a donc décidé qu’à situation exceptionnelle, mesure inédite, et appel à la solidarité de ses membres. « De 2005 à 2007, soit sur deux exercices comptables, nous sollicitons tous les ministres et lieux d’Eglise pour constituer une somme d’environ 800'000 francs », explique Antoine Reymond. Chacun mettra ce qu’il veut ou peut, et sur une base totalement anonyme. « Nous nous sommes contentés de suggérer une base de calcul en fonction du salaire et des charges ».
Ce système très protestant d’appel à la liberté et à la conscience personnelles semble avoir été bien accueilli par la majorité. « Nous avons présenté ce projet en janvier et nous avons reçu immédiatement un tiers de réponses positives », détaille Antoine Reymond. Quelques semaines plus tard, une nouvelle séance de travail à Crêt-Bérard réunissait plus de 200 ministres. Le démarrage de l’opération est prévu en mai prochain. D’après les premiers calculs, 200’000 francs par an, soit la moitié de la somme espérée, pourraient d’ores et déjà être récoltés. « Si nous n’y parvenons pas, avertit Claude Cuendet, nous devrons dépenser près de 40% de notre fortune sans les immeubles, ce qui constituerait un danger ».
Aumônier au CHUV, Daniel Pétremand croit exprimer le sentiment de la majorité en approuvant cette « solidarité partagée par tout le corps ministériel et l’ensemble du corps de l’Eglise à l’égard de certains de ses membres ». Si le fond paraît ainsi largement approuvé, la forme perturbe davantage. « Certains de mes collègues y ont ressenti une demande assez arbitraire, d’autant que même si chacun demeure libre de participer ou non, on titille tout de même notre loyauté vis-à-vis de l’institution ». L’avenir dira si cette fidélité évitera un ou plusieurs licenciements malgré la réduction des postes annoncées.