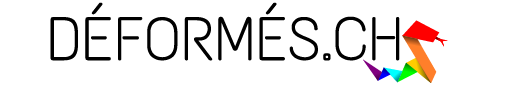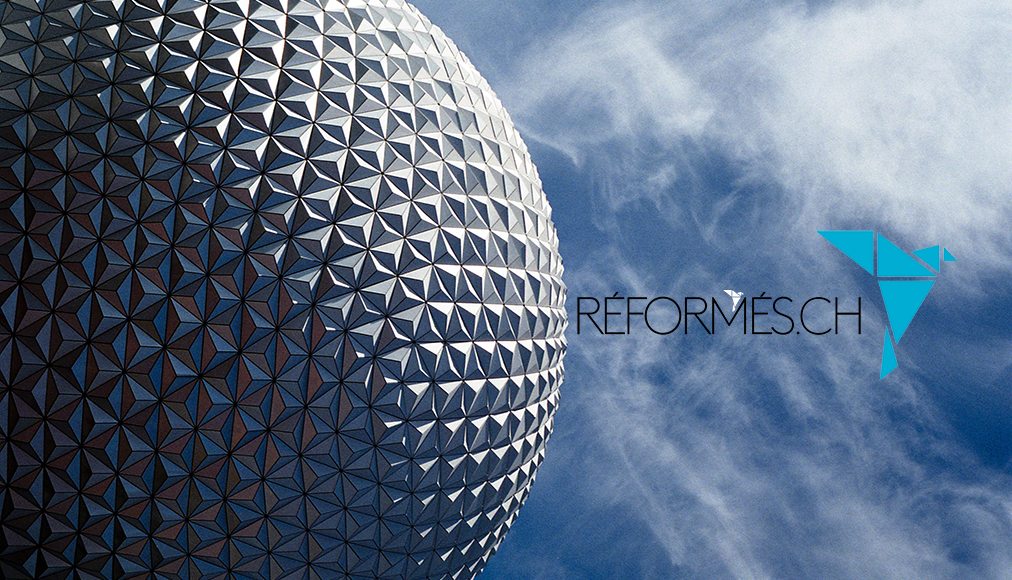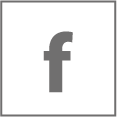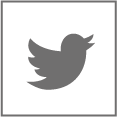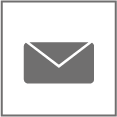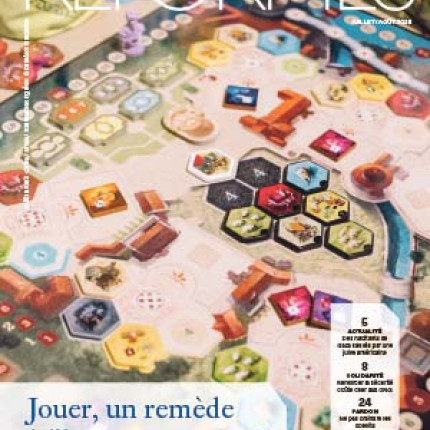Couple homosexuel : les Eglises en débat
10 mars 2005
La Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) publie aujourd'hui même un argumentaire pour expliquer son soutien à la loi sur le partenariat entre personnes du même sexe, soumise à votation le 5 juin prochain
En même temps, une enquête fouillée d'une journaliste du quotidien français La Croix rappelle les rapports complexes du christianisme et de l'homosexualité. Et les origines du refus catholique. L’été dernier, le Parlement suisse a adopté une loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe. En octobre, lancé par les deux partis religieux – l’Union démocratique fédérale (UDF) et le Parti évangélique populaire (PE) - un référendum contre ce texte législatif a abouti avec plus de 66'000 signatures. C’est donc le peuple qui aura le dernier mot, le 5 juin prochain, en même temps qu’il se prononcera sur l’espace Schengen.
Le débat public autour de cette première reconnaissance légale, et donc sociale, des couples homosexuels démarre. Le 21 mars prochain, le camp favorable à la loi tirera ses premières salves avec une conférence de presse de la « Coordination pour le oui », composée de quatre associations nationales gays et lesbiennes. De son côté, le comité « non à la loi » met en avant plusieurs griefs, dont l’affaiblissement sociopolitique de la famille et un coût qualifié de « démesuré ».Un vieux débat dans l’EgliseConsultées lors de l’élaboration du projet de loi, les Eglises seront présentes dans la discussion. Comme le rappelle une éclairante enquête* réalisée par Claire Lesegretain, responsable adjointe du service religion du quotidien français La Croix, elles entretiennent depuis longtemps des rapports complexes avec la question homosexuelle. Ainsi, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) publie une brochure argumentative qu’elle s’apprête à envoyer à toutes ses Eglises membres. La FEPS s’y déclare clairement en faveur de la loi. Voilà qui ne constitue pas une surprise : « En une douzaine d’années de débats internes, précise son porte-parole Simon Weber, le Conseil de la FEPS a exprimé à trois reprises son adhésion à un statut juridiquement reconnu pour les partenariats entre personnes du même sexe ». A cet égard, la FEPS estime notamment qu’il convient de distinguer la question juridique, en question ici, de la question éthique. Ainsi, selon elle - et contrairement à l’avis des neinsagers - « l’amélioration du statut juridique des couples de même sexe n’a pas d’incidence négative sur le statut social du mariage et de la famille ».
Cette position s’avère conforme à l’avis exprimé par la Fédération protestante de France (FPF) lors du débat sur le pacs en 1998. Cette dernière affirmait son soutien à une « conjugalité » homosexuelle, mais refusait toute idée de « parentalité », autrement dit toute possibilité pour un couple de même sexe d’adopter un enfant.
La plupart des Eglises réformées cantonales devrait suivre le mot d’ordre donné par la FEPS. Cette unanimité cache quelques regrets. Ainsi, en France, le fondateur de la Commission d’éthique de la FPF, Olivier Abel, avoue déplorer que le pacs « soit un simple contrat facilement résiliable, instaurant des avantages fiscaux, mais ne disant rien du devoir de fidélité et d’entraide dans la durée que se doivent des personnes liées entre elles ». D’autre part, le monde protestant demeure divisé sur la question d’une bénédiction des unions homosexuelles. La fameuse loi naturelleLes communautés évangéliques, elles, s’opposent à tout changement. Leurs arguments sont peu ou prou ceux brandis par la Conférence des évêques suisses (CES), qui s’aligne elle-même sur la position toujours défendue par le Magistère romain, et déjà reprise par leurs collègues français pour rejeter le pacs : il ne saurait être question d’accepter une légitimation juridique d’une forme « non conforme » de la vie privée. Ainsi que l’explique Claire Lesegretain dans sa recherche, c’est dans cette même perspective qu’il faut comprendre le refus de la hiérarchie catholique d’envisager la bénédiction. La CES dit à ce sujet : « Chaque personne peut recevoir une bénédiction non sacramentelle donnée liturgiquement. Mais chaque action de l’homme ne saurait être approuvée par Dieu. Nous avons la conviction que des personnes homosexuelles peuvent être bénies, mais non la contraction d’une union homosexuelle ».
Bref, pour les catholiques, le couple de même sexe ne sera jamais qu’un couple par « analogie », en décalage avec l’anthropologie judéo-chrétienne fondée sur la polarité sexuelle. Dans ce même ouvrage, soeur Véronique Margron, dominicaine et enseignante de théologie morale à l’Institut catholique de Paris, résume ainsi les fondements de la vision catholique : « Dans la Bible comme dans la Tradition, la sexualité est fondée dans la différence sexuelle qui rend possible la procréation ». Selon la fameuse « loi naturelle », Dieu crée d’emblée l’humain différencié sexuellement. Le lien entre l’homme et la femme est « analogue à celui qui existe entre Dieu et l’humanité, et entre le Christ et l’Eglise. La loi naturelle insiste sur le rôle et la nécessité de maintenir les différences : entre les générations, entre les vivants et les morts, entre les sexes. Car dès lors qu’elles ne sont plus respectées et qu’il y a confusion, il y a violence ». Seule exception officielle pour l’heure chez les catholiques : la Fédération des femmes catholiques, favorables au partenariat. UTILE
*Claire Lesegretain, Les Chrétiens et l’homosexualité : l’enquête, Presses de la Renaissance, 2005.
Le débat public autour de cette première reconnaissance légale, et donc sociale, des couples homosexuels démarre. Le 21 mars prochain, le camp favorable à la loi tirera ses premières salves avec une conférence de presse de la « Coordination pour le oui », composée de quatre associations nationales gays et lesbiennes. De son côté, le comité « non à la loi » met en avant plusieurs griefs, dont l’affaiblissement sociopolitique de la famille et un coût qualifié de « démesuré ».Un vieux débat dans l’EgliseConsultées lors de l’élaboration du projet de loi, les Eglises seront présentes dans la discussion. Comme le rappelle une éclairante enquête* réalisée par Claire Lesegretain, responsable adjointe du service religion du quotidien français La Croix, elles entretiennent depuis longtemps des rapports complexes avec la question homosexuelle. Ainsi, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) publie une brochure argumentative qu’elle s’apprête à envoyer à toutes ses Eglises membres. La FEPS s’y déclare clairement en faveur de la loi. Voilà qui ne constitue pas une surprise : « En une douzaine d’années de débats internes, précise son porte-parole Simon Weber, le Conseil de la FEPS a exprimé à trois reprises son adhésion à un statut juridiquement reconnu pour les partenariats entre personnes du même sexe ». A cet égard, la FEPS estime notamment qu’il convient de distinguer la question juridique, en question ici, de la question éthique. Ainsi, selon elle - et contrairement à l’avis des neinsagers - « l’amélioration du statut juridique des couples de même sexe n’a pas d’incidence négative sur le statut social du mariage et de la famille ».
Cette position s’avère conforme à l’avis exprimé par la Fédération protestante de France (FPF) lors du débat sur le pacs en 1998. Cette dernière affirmait son soutien à une « conjugalité » homosexuelle, mais refusait toute idée de « parentalité », autrement dit toute possibilité pour un couple de même sexe d’adopter un enfant.
La plupart des Eglises réformées cantonales devrait suivre le mot d’ordre donné par la FEPS. Cette unanimité cache quelques regrets. Ainsi, en France, le fondateur de la Commission d’éthique de la FPF, Olivier Abel, avoue déplorer que le pacs « soit un simple contrat facilement résiliable, instaurant des avantages fiscaux, mais ne disant rien du devoir de fidélité et d’entraide dans la durée que se doivent des personnes liées entre elles ». D’autre part, le monde protestant demeure divisé sur la question d’une bénédiction des unions homosexuelles. La fameuse loi naturelleLes communautés évangéliques, elles, s’opposent à tout changement. Leurs arguments sont peu ou prou ceux brandis par la Conférence des évêques suisses (CES), qui s’aligne elle-même sur la position toujours défendue par le Magistère romain, et déjà reprise par leurs collègues français pour rejeter le pacs : il ne saurait être question d’accepter une légitimation juridique d’une forme « non conforme » de la vie privée. Ainsi que l’explique Claire Lesegretain dans sa recherche, c’est dans cette même perspective qu’il faut comprendre le refus de la hiérarchie catholique d’envisager la bénédiction. La CES dit à ce sujet : « Chaque personne peut recevoir une bénédiction non sacramentelle donnée liturgiquement. Mais chaque action de l’homme ne saurait être approuvée par Dieu. Nous avons la conviction que des personnes homosexuelles peuvent être bénies, mais non la contraction d’une union homosexuelle ».
Bref, pour les catholiques, le couple de même sexe ne sera jamais qu’un couple par « analogie », en décalage avec l’anthropologie judéo-chrétienne fondée sur la polarité sexuelle. Dans ce même ouvrage, soeur Véronique Margron, dominicaine et enseignante de théologie morale à l’Institut catholique de Paris, résume ainsi les fondements de la vision catholique : « Dans la Bible comme dans la Tradition, la sexualité est fondée dans la différence sexuelle qui rend possible la procréation ». Selon la fameuse « loi naturelle », Dieu crée d’emblée l’humain différencié sexuellement. Le lien entre l’homme et la femme est « analogue à celui qui existe entre Dieu et l’humanité, et entre le Christ et l’Eglise. La loi naturelle insiste sur le rôle et la nécessité de maintenir les différences : entre les générations, entre les vivants et les morts, entre les sexes. Car dès lors qu’elles ne sont plus respectées et qu’il y a confusion, il y a violence ». Seule exception officielle pour l’heure chez les catholiques : la Fédération des femmes catholiques, favorables au partenariat. UTILE
*Claire Lesegretain, Les Chrétiens et l’homosexualité : l’enquête, Presses de la Renaissance, 2005.