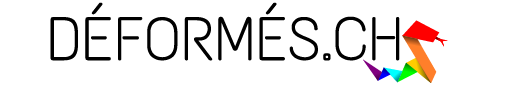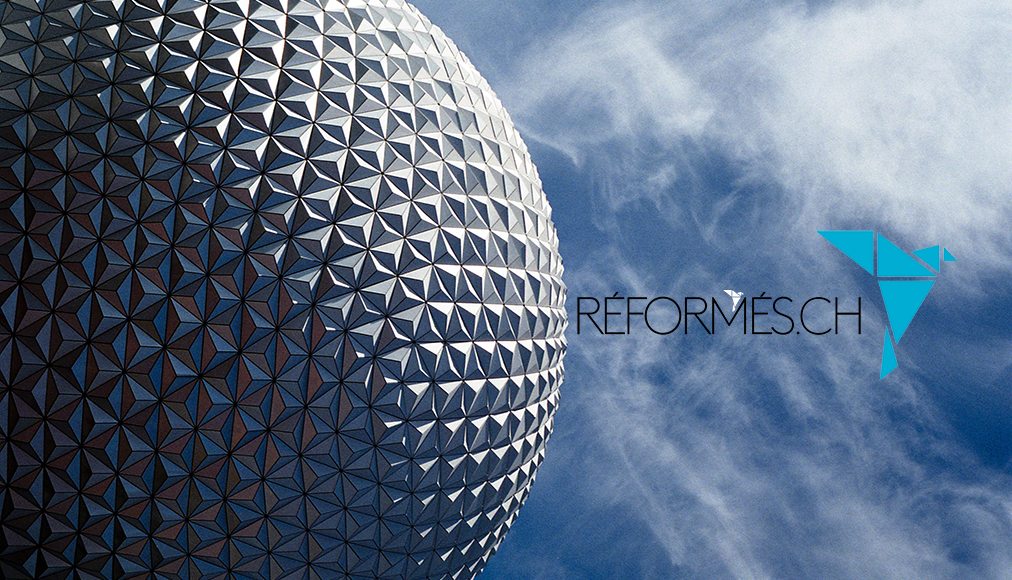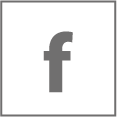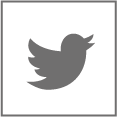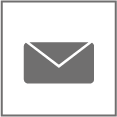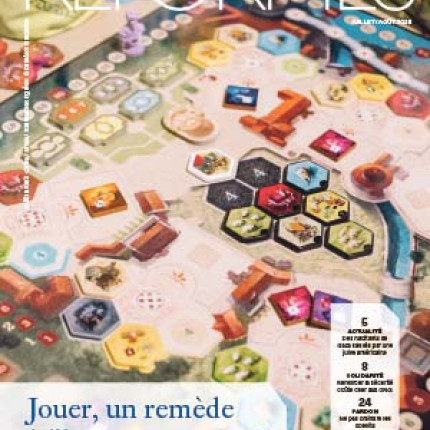Nouveau séminaire à la Faculté de théologie de Lausanne :L’argent, parlons-en !
« Parlez-moi d’argent » : lancé par un théologien protestant, le séminaire qui démarre le mardi 5 avril prochain à la Faculté de théologie de l’Université de Lausanne, a un petit côté frondeur. Alors qu’on parle aujourd’hui librement d’amour et de sexe, on a de la peine à dévoiler son rapport à l’argent. Le sujet serait-il obscène ? A l’heure où les gens découvrent dans les médias les salaires astronomiques servis aux grands patrons et où une frange toujours plus large de la population s’appauvrit, Daniel Marguerat a jugé important de proposer une approche pluridisciplinaire de la question des ressources économiques et de l’usage qui en est fait dans notre société. Il a invité l’économiste Alexandre Bergmann, professeur à l’Université de Lausanne, Olivier Spinnler, médecin psychothérapeute, Denis Müller, éthicien, Luciano Manicardi, frère de la communauté monastique œcuménique de Bose, et deux théologiens de l’Université de Neuchâtel, Nicoletta Acatrinei et le professeur Félix Moser. Chacun articulera réflexion théorique et expérience. A commencer par Daniel Marguerat qui s’implique personnellement, en acceptant d’expliquer que son rapport à l’argent s’enracine dans son histoire personnelle et qu’il a été marqué dans l’enfance par la peur de manquer : « Explorer mon rapport aux questions matérielles m’a permis de me décrisper sur ces questions. Je me sens aujourd’hui beaucoup plus libre », reconnaît-il. Et le doyen de la Faculté de théologie d’élargir le propos : « L’argent est un facteur déterminant dans l’histoire aussi bien personnelle que celle du monde. L’économie pèse de plus en plus lourd dans nos sociétés, elle devient une « loi » indiscutable et universelle devant laquelle on devrait tous s’incliner. Il est urgent de mener une réflexion sur ce totalitarisme économique qui ne tient pas compte du facteur humain, qui largue les gens, et d’analyser la manière dont la puissance financière a supplanté d’autres valeurs qui lui étaient concurrentes ».
Une relecture de l’histoire du christianisme s’impose pour apprivoiser ses ambiguïtés et ses rapports troubles avec l’argent. La tradition protestante n’est pas en reste : comme elle avait pour vocation de gérer la Création et de la faire fructifier, elle a largement prôné les vertus du travail. Consacrer chaque minute à gagner de l’argent pour la plus grande gloire de Dieu était, pour Benjamin Franklin au 18e siècle, un devoir de chrétien. L’approche développée par Max Weber dans « Ethique protestante et esprit du capitalisme », a mis en évidence le lien entre ascétisme puritain dans la vie privée et dynamisme économique. A travers sa lecture du témoignage biblique, Daniel Marguerat relève que l’argent a un rôle positif à jouer dans la construction des relations, qu’il est considéré comme une bénédiction divine, du moment qu’il ne sert pas les volontés d’accaparement par l’individu, mais favorise son confort de vie, sans oublier celui d’autrui. « Il est urgent de se « dé fasciner » de l’argent et d’en dénoncer le totalitarisme. Dans nos sociétés occidentales, on ne manque pas d’argent, on y souffre d’un déséquilibre criant et grandissant de la répartition des richesses. L’argent est accaparé par une toute petite élite. Il faut travailler à mettre en place un système politique et des lois qui permettent de répartir les richesses le plus équitablement possible entre tous, qui soit ouvert à la détresse d’autrui ».