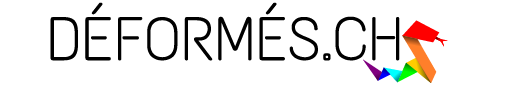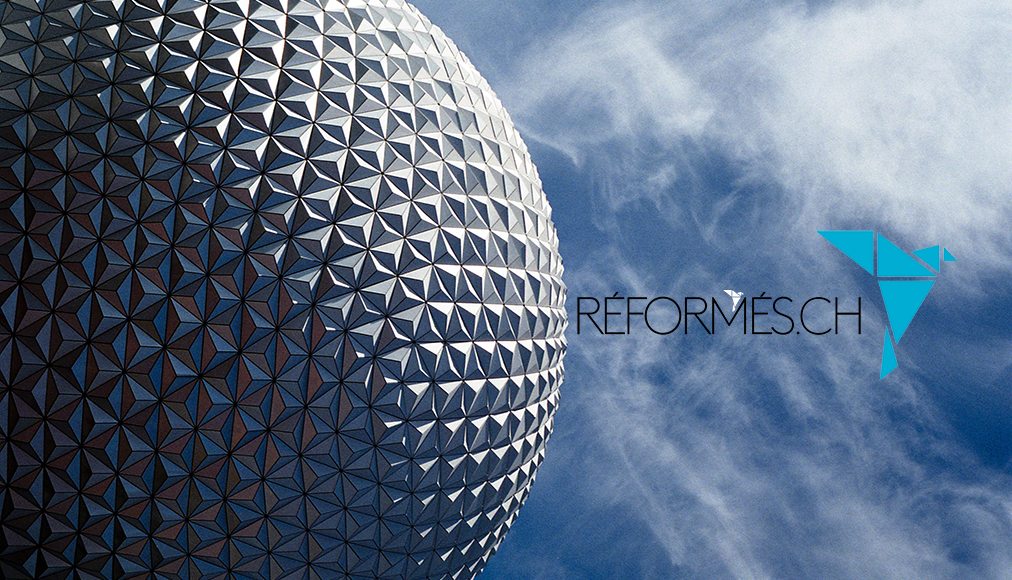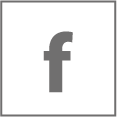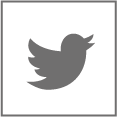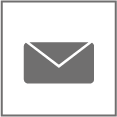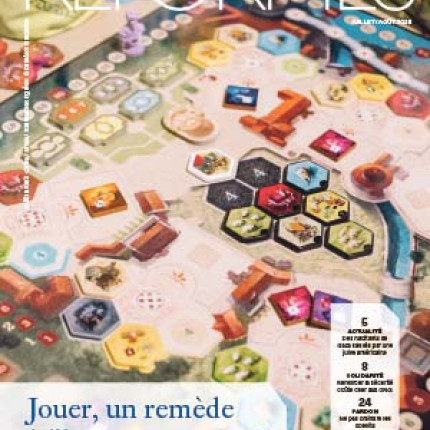Sous le soleil de Satan
Le diable a la cote. Dans le box-office hollywoodien, comme le prouve un énième avatar actuellement sur nos écrans (Constantine). Mais Satan tient aussi le dessus du pavé dans la publicité ou la littérature; voire en politique où un Georges W. Bush semble intimement convaincu que « l'axe du mal » a un visage cornu et une queue fourchue.
Pourtant, comme l'a rappelé lors du Café théologique de mardi dernier le professeur lausannois Thomas Römer, « c'est seulement au Moyen Age, lorsque Etat et Eglise tentent d'affirmer leur pouvoir, que le diable se met à représenter un contre-pouvoir, un repoussoir ». Auparavant, dans les premiers siècles qui suivirent la mort de Jésus, Satan n'inquiète personne et ne provoque guère de crainte. « Saint Augustin lui attribue tout ce qui touche à la sexualité, rapprochement qui a perduré depuis. On est là du côté de la fascination, de tout un imaginaire lié à la mythologie », note encore Thomas Römer.
Une chose a frappé le bibliste: si le diable apparaît plus de deux cents fois dans le Nouveau Testament, rares en sont les traces dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? « Parce que le diable naît avec l'affirmation d'un Dieu unique et l’avènement du monothéisme. Avec leurs nombreuses divinités bonnes ou mauvaises, et parfois un peu des deux, les polythéismes s'en passaient très bien ». Ainsi, dans la Grèce antique. Le dieu Pan a beaucoup inspiré les premières représentations de Satan, c'est pourquoi le second ressemble beaucoup au premier mais « si sa sexualité est présentée comme débordante, Pan est davantage taquin que méchant ».
Avec la certitude que le Dieu d'Israël est aussi « celui de tous les hommes », grandit également l’incertitude quant à l'origine du mal. Le « créateur de toute chose » se trouve-t-il aussi à la naissance du mal ? Petit à petit grandit alors l'importance de Lucifer - littéralement, en latin, celui qui porte la lumière - ange déchu pour s'être opposé à Dieu. « Les causes de sa chute demeurent variées, l'une d'entre elles suggérant qu'il fut puni pour avoir refusé de se prosterner devant Adam et Eve ». Cette explicitation des causes du mal par la faute d’un être d'origine céleste descendu sur puis sous terre, n'est pas la seule que l'on trouve dans les Ecritures, mais c'est elle qui fera fortune. Selon Thomas Römer, cette montée en puissance du « malin » s'explique également par une « vision dualiste du monde qui se fait peu à peu jour entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, liée à la conviction d’une fin du monde imminente ».
Au XVIIIe siècle, avec les Lumières et le rationalisme, l’Eglise arrête de voir des possédés et des démoniaques partout et l’on se fait plus discret quant à l’omniprésence du maître des enfers dont Voltaire dira qu’il fut « la meilleure invention de l’Eglise pour affirmer son pouvoir ». Le diable quitte l’existence quotidienne et entre en littérature comme dans les représentations artistiques en général.
Alors, quid ? « Paul comme Luther voyaient bien le diable comme une personne. Cela signifie-t-il que nous devons continuer à le penser de nos jours ? Et s’il était plutôt une manière de nous interroger sur le mal ? Cela me paraît être la vraie question, conclut Thomas Römer, et le diable la mauvaise réponse ». En revanche, selon l’orateur, Satan « peut nous aider à prendre conscience que nous ne sommes pas maîtres de l’univers », et que, selon la jolie expression d’Eric-Emmanuel Schmitt, nous avons tous « notre part d’ombre ».